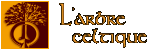|
Les fourreaux dﻗﺣ۸pﺣ۸e latﺣ۸niensModﺣ۸rateurs: Pierre, Guillaume, Patrice Pour revenir sur les spﺣ۸cialisations guerriﺣ۷res que l'on pourrait associer ﺣ la symbolique des fourreaux.
La lyre zoomorphe cotoie les ﺣ۸pﺣ۸es Hatvan Boldog. Je mentionnais que ce type d'ﺣ۸pﺣ۸e comprenait deux sous types : lame nervurﺣ۸ d'une soixantaine de cm de long (poignﺣ۸e comprise), fourreau ﺣ nervure centrale et paire de griffons ; lame diamantﺣ۸ mﺣ۹me longueur environ, fourreau sans nervure centrale, frette ﺣ triscﺣ۷les. La lyre apparait toujours sur des armes plus puissantes que les Hatvan citﺣ۸es ci dessus. mais les deux sous types de Htavan se distinguent entre eux : la lame nervurﺣ۸ est plus lﺣ۸gﺣ۷re que la lame diamantﺣ۸. Evidemment il ne s'agit que d'une diffﺣ۸rence de quelques grammes ! Donc je me pose la question d'une incidence rﺣ۸elle sur le mode de combat ! C'est pour cela que j'ﺣ۸mettais l'hypothﺣ۷se d'une distinction d'ﺣ۱ge entre les porteurs de l'un ou l'autre type : la frette ﺣ triscﺣ۷le ﺣ۸quiperait les guerriers en cour de formation. mais pour corroborer cette idﺣ۸e il faudrait ce que livre l'anthropologie associﺣ۸e ﺣ ces armes ! Donc il est certain qu'entre les ﺣ۸pﺣ۸es avec fourreau ﺣ lyre zoomorphe et Hatvan Boldog il y a une rﺣ۸elle diffﺣ۸rence, ce qui induit des spﺣ۸cialisations guerriﺣ۷res. Enfin lors de la "disparition" des types Hatvan Boldog, on assiste ﺣ "l'explosion" de l'ornementation des fourreaux d'ﺣ۸pﺣ۸es. Ces armes sont toutes plus massives que les Hatvan... Les spﺣ۸cialisations sont-elles plus diffuses ? Les hypothﺣ۸tiques ﺣ۸coles de guerres susceptibles d'ﺣ۹tre responsables de l'existence des Hatvan ont-elles disparues ? Doit-on mettre ces changements en relations avec l'activitﺣ۸ militaire plus ou moins intense suivant les annﺣ۸es ? Ce qui me semble trﺣ۷s logique ! VAE VICTIS
http://www.archeoart.org
Wow, tout cela demande rﺣ۸flexion, Tigerne Leukirix !
 Jean-Paul Brethenoux. Sedullos Lemouico immi exobnos in catue ! ﺳ۲ﺳﺳﺳﺳ۴ﺳﺳﺳﺳ۲ (Graecum est, non legitur !)
"Honorer les dieux, ne pas faire le mal, s'exercer ﺣ la bravoure."
Salut ﺣ tous,
Voici un lien vers un post de DT avec les illustrations des griffons : http://www.forum.arbre-celtique.com/vie ... 4646#44646 J'en profite pour signaler une erreur que j'avais commise sur ce fil. Les griffons ou dragons sont gﺣ۸nﺣ۸ralement sur la plaque externe, l'avers du fourreau et non pas sur la plaque interne, le revers qui touche la jambe du combattant. C'est elle qui porte le pontet mﺣ۸tallique qui fait partie du systﺣ۷me de suspension. Gournay III, Les fourreaux dﻗﺣ۸pﺣ۸e : Le sanctuaire de Gournay-sur-Aronde et lﻗarmement des Celtes de La Tﺣ۷ne moyenne / Thierry Lejars. - Paris : Errance : I.N.R.A.P, 1994. - 234 p. - (Archﺣ۸ologie aujourd'hui) Les fourreaux d'ﺣ۸pﺣ۸e : Un chef d'oeuvre de l'art de la forge des Celtes / Andrﺣ۸ Rapin, pp. 66-75 in Les Celtes et les arts du feu, Dossier d'archﺣ۸ologie, nﺡﺍ 258, novembre 2000.-.- Dijon : Editions Faton, 2000.- 86 p.- (Dossier d'archﺣ۸ologie ; nﺡﺍ 258) Derniﺣ۷re ﺣ۸dition par Sedullos le Mer 13 Fﺣ۸v, 2008 20:15, ﺣ۸ditﺣ۸ 4 fois.
Jean-Paul Brethenoux. Sedullos Lemouico immi exobnos in catue ! ﺳ۲ﺳﺳﺳﺳ۴ﺳﺳﺳﺳ۲ (Graecum est, non legitur !)
"Honorer les dieux, ne pas faire le mal, s'exercer ﺣ la bravoure."
Sur la figure 1, on distingue l'entrﺣ۸e du fourreau en haut et la bouterolle en bas, il manque la partie mﺣ۸diane.
Les griffons sont en haut ﺣ droite et le pontet en haut ﺣ gauche. Voici ce qu'ﺣ۸crit Andrﺣ۸ Rapin dans l'article citﺣ۸ :
Jean-Paul Brethenoux. Sedullos Lemouico immi exobnos in catue ! ﺳ۲ﺳﺳﺳﺳ۴ﺳﺳﺳﺳ۲ (Graecum est, non legitur !)
"Honorer les dieux, ne pas faire le mal, s'exercer ﺣ la bravoure."
Les griffons de la figure 1 sont les plus anciens, en raison des caractﺣ۷ristiques de la bouterolle et du pontet, nous sommes au dﺣ۸but du 4e s av J.C. Je les placerais plutﺣﺑt dans la catﺣ۸gorie des lyres, mais ils se font faces. Le symbole le plus reprﺣ۸sentatif est la paire de griffons de la figure 3, l'entrﺣ۸ du fourreau couchﺣ۸... Comme il n'y a pas de bouterolle, pas moyen de dater (ce qui est de toute faﺣ۶on dﺣ۸jﺣ datﺣ۸
Sedullos, je me permet une remarque ﺣ propos de la portion de texte d'A Rapin, "...grade et fonction militaire des guerriers..." tu dois prﺣ۸ciser qu'il s'agit d'une hypothﺣ۷se... VAE VICTIS
http://www.archeoart.org
Salut, Leukirix,
Je sais mais Andrﺣ۸ Rapin lui-mﺣ۹me ne le prﺣ۸cisait pas dans l'article ! A propos des ﺣ۸pﺣ۸es Hatvan-Boldog, tu parles d'une lame diamantﺣ۸e, peux-tu prﺣ۸ciser ? Derniﺣ۷re ﺣ۸dition par Sedullos le Dim 24 Fﺣ۸v, 2008 10:47, ﺣ۸ditﺣ۸ 1 fois.
Jean-Paul Brethenoux. Sedullos Lemouico immi exobnos in catue ! ﺳ۲ﺳﺳﺳﺳ۴ﺳﺳﺳﺳ۲ (Graecum est, non legitur !)
"Honorer les dieux, ne pas faire le mal, s'exercer ﺣ la bravoure."
En effet, le terme "section losangique" est plus appropriﺣ۸. Il s'agit de la forme des lames d'un des deux types de Hatvan Boldog. Le fourreau accompagnant ces lames est toujours sans nervures centrales sur la plaque de droit et le dﺣ۸cor se limite ﺣ une frette muni de deux grosses bosses ornﺣ۸es de triscﺣ۷les. les lames du second type d'Hatvan sont toujours ﺣ section nervurﺣ۸e, le fourreau est toujours ornﺣ۸ d'une nervure centrale sur la plaque de droit et la paire de griffons dﺣ۸cor le haut de la plaque. Ces deux types d'ﺣ۸pﺣ۸es font moins de 60cm de longueur dans leur totalitﺣ۸.
Les lames ﺣ section losangique sont plus massives que les lames nervurﺣ۸s plus fines dans leurs ﺣ۸paisseurs, le plus gros de la matiﺣ۷re ﺣ۸tant concentrﺣ۸ justement au niveau de la nervure. Donc je disais que l'on pouvait se poser la question de la nature du maniement de ces deux armes, car mﺣ۹me si la lame losangique est plus lourde que celle nervurﺣ۸e, la diffﺣ۸rence de poids ne joue que sur quelques grammes. Donc peut-on rﺣ۸ellement envisagﺣ۸ une incidence sur le maniement ? En suivant ce raisonnement j'ﺣ۸carte donc l'hypothﺣ۷se de spﺣ۸cialitﺣ۸s militaires diffﺣ۸rentes pour ces deux types d'armes. C'est pour cela que je propose entre autre une diffﺣ۸renciation d'ﺣ۱ge pour les porteurs de ces armes. Le type ﺣ lame losangique avec fourreau ﺣ frettes ﺣ triscﺣ۷les serait dﺣ۸volue aux jeunes guerriers en cour d'apprentissage. Je m'appuie sur la dﺣ۸couverte d'un adolescent ﺣ Barbey qui portait un torque entiﺣ۷rement fermﺣ۸ dont le diamﺣ۷tre indique qu'il avait ﺣ۸tﺣ۸ passﺣ۸ lors de sa naissance et l'arme qui l'accompagnait ﺣ۸tait justement une Hatvan avec frette ﺣ triscﺣ۷les. Le problﺣ۷me est que je manque de donnﺣ۸es, il serait bon de savoir combien de ces armes ont ﺣ۸tﺣ۸ trouvﺣ۸s avec un adolescent. Ou si quelques unes ont ﺣ۸tﺣ۸ retrouvﺣ۸es avec un adulte, ce qui mettrait bien ﺣ۸videmment ﺣ mal mon hypothﺣ۷se. VAE VICTIS
http://www.archeoart.org
Salut,
Cela se prﺣ۸cise, merci pour toutes ces info J'avais ﺣ۸mis une phypothﺣ۷se en 2004, dans mon article, Armes et techniques de combat des Gaulois au Ier siﺣ۷cle avant J.-C. / Jean-Paul Brethenoux, Histoire antique, Hors sﺣ۸rie nﺡﺍ 5, La guerre des Gaules : Vercingﺣ۸torix et le sursaut celtique.- Apt : Editions Harnois, 2004. [p. 60-69] A savoir, l'existence possible de : "guerriers spﺣ۸cialisﺣ۸s dans le "nettoyage" ﺣ l'ﺣ۸pﺣ۸e. Concrﺣ۹tement des ﺣ۸pﺣ۸istes suivent les vagues de lanciers et achﺣ۷vent tous les ennemis ﺣ terre. je n'avais pas prﺣ۸cisﺣ۸ si les armes frappaient d'estoc ou de taille ou les deux. Ce type de combattant existait dans les armﺣ۸es mﺣ۸diﺣ۸vales au XIVe et XVe siﺣ۷cle, comme certains coutiliers, armﺣ۸s de couteaux ou dagues perce-mailles suivant les vougiers et guisarmiers. Un type particulier de longue dague ou courte ﺣ۸pﺣ۸e, nommﺣ۸e misﺣ۸ricorde, permettait aussi par un geste de haut en bas, d'avant en arriﺣ۷re en tenant l'arme ﺣ la faﺣ۶on d'un poignard d'achever les combattants gravement blessﺣ۸s de son propre parti ou un ennemi sans se pencher en flﺣ۸chissant lﺣ۸gﺣ۷rement les genoux Je sais bien que si les comparaisons avec les guerres mﺣ۸diﺣ۸vales sont pﺣ۸rilleuses, je continue ﺣ penser que de telles mﺣ۸thodes ont pu exister. Du point de vue de la gestuelle, on peut examiner sur la plaque du fond du chaudron de Gundestrup la position trﺣ۷s curieuse de la main du guerrier attaquant le taureau. Il s'agit pour moi d'une estocade, un coup de pointe, avec le pommeau de l'ﺣ۸pﺣ۸e qui est saisi par le haut de la main. http://img156.imageshack.us/img156/8986/pmgundbottomje5.jpg Derniﺣ۷re ﺣ۸dition par Sedullos le Jeu 14 Fﺣ۸v, 2008 19:59, ﺣ۸ditﺣ۸ 1 fois.
Jean-Paul Brethenoux. Sedullos Lemouico immi exobnos in catue ! ﺳ۲ﺳﺳﺳﺳ۴ﺳﺳﺳﺳ۲ (Graecum est, non legitur !)
"Honorer les dieux, ne pas faire le mal, s'exercer ﺣ la bravoure."
Pour revenir aux griffons,
Marc Bacault et Jean-Loup Flouest suggﺣ۷rent une interprﺣ۸tation du motif aux griffons de la plaque festonnﺣ۸e de la tombe ﺣ char de Cuperly, Champagne, fin du Ve siﺣ۷cle av. J.-C. mettant en relation influences pythagoriciennes et aire d'extension du culte de l'Apollon hyperborﺣ۸en ; les griffons en tant que gardiens du dieu. Schﺣ۸mas de construction des dﺣ۸cors au compas des phalﺣ۷res latﺣ۸niennes de Champagne / Marc Bacault et Jean-Loup Flouest, pp.-145-170 in Dﺣ۸cors, images et signes de l'ﺣ۱ge du Fer europﺣ۸en : Actes du XXVIe Colloque de l'Association Franﺣ۶aise pour l'Etude de l'Age du fer : Paris et Saint Denis, 9-12 mai 2002ﻗ۵ / ﺣ۸ditﺣ۸ par O. Buchsenschutz, A. Bulard, M.-B. Chardenoux, N. Ginoux.- Tours : FERACF, 2003.- 280 p.- (Supplﺣ۸ment ﺣ la Revue Archﺣ۸ologique du Centre de la France ; 24) Jean-Paul Brethenoux. Sedullos Lemouico immi exobnos in catue ! ﺳ۲ﺳﺳﺳﺳ۴ﺳﺳﺳﺳ۲ (Graecum est, non legitur !)
"Honorer les dieux, ne pas faire le mal, s'exercer ﺣ la bravoure."
On a plutﺣﺑt l'impression que l'estocade s'apprﺣ۹te ﺣ ﺣ۹tre donnﺣ۸ dans un endroit fort peu recommandable du chien !
Hum ! Pour revenir ﺣ ta rﺣ۸flexion Sed concernant les mﺣ۸thodes mﺣ۸diﺣ۸vales, il faut prﺣ۸ciser, que les troupes de rﺣ۸serves armﺣ۸es de lances peuvent tout aussi exﺣ۸cuter les "tﺣ۱ches" que tu dﺣ۸cris, d'autant plus que les hommes sont tout de mﺣ۹me moins carapaﺣ۶onnﺣ۸s durant l'antiquitﺣ۸. La lance maintenu ﺣ la verticale, pour ﺣ۸viter de blesser ses camarades de devant peuvent avoir un autre emploi, celui d'achever les blessﺣ۸s ennemis ﺣ condition que l'armﺣ۸e en question soit victorieuse et avance... VAE VICTIS
http://www.archeoart.org
Bon, je m'excuse auprﺣ۷s du chien
Souviens-toi que Andrﺣ۸ Rapin a insistﺣ۸ sur le fait que certains talons de lances ﺣ۸taient volontairement ﺣ۸moussﺣ۸s pour ne pas blesser ceux qui suivent. Les unitﺣ۸s de trois piﺣ۸tons que tu ﺣ۸voques dans ton livre pourraient aussi liquider des blessﺣ۸s. C'est compliquﺣ۸ ! Jean-Paul Brethenoux. Sedullos Lemouico immi exobnos in catue ! ﺳ۲ﺳﺳﺳﺳ۴ﺳﺳﺳﺳ۲ (Graecum est, non legitur !)
"Honorer les dieux, ne pas faire le mal, s'exercer ﺣ la bravoure."
Salut ﺣ tous,
Pour revenir ﺣ Gundestrup, j'ai plutﺣﺑt l'impression de voir un guerrier mort, un taureau immolﺣ۸, et un autre animal difficile ﺣ reconnaﺣ؟tre dans le bas ; seul un chien, un loup, semble encore exister ? La position des membres infﺣ۸rieurs, repliﺣ۸s, mﺣ۹me s'il s'agit d'une obligation matﺣ۸rielle dans la reprﺣ۸sentation, me semble trop significative. Il ne faut pas oublier que la perspective en reprﺣ۸sentation est une chose assez rﺣ۸cente ; si je ne me trompe pas, elle n'apparaﺣ؟t dans les miniatures mﺣ۸diﺣ۸vales occidentales qu'ﺣ partir du XIIe-XIIe siﺣ۷cles. A+
En bas, ﺣ۶a doit ﺣ۹tre un lﺣ۸zard.
Il ne me semble pas que le guerrier soit mort. Ce qui m'intﺣ۸ressait c'ﺣ۸tait la position de l'ﺣ۸pﺣ۸e dans sa main. Jean-Paul Brethenoux. Sedullos Lemouico immi exobnos in catue ! ﺳ۲ﺳﺳﺳﺳ۴ﺳﺳﺳﺳ۲ (Graecum est, non legitur !)
"Honorer les dieux, ne pas faire le mal, s'exercer ﺣ la bravoure."
Oui pour les talons Sedullos, mais pas pour tous, nombre d'entre eux sont bien pointus. Mais en tenant la lance verticalement, le fer de lance peut aussi ﺣ۹tre dirigﺣ۸ vers le bas...
VAE VICTIS
http://www.archeoart.org
J'ai ﺣ۸galment oubliﺣ۸ une prﺣ۸cision, il s'agit des poignﺣ۸es de ces ﺣ۸pﺣ۸es type Hatvan.
Pour les fourreaux ornﺣ۸s de griffons, les soies sont plus longues que pour les ﺣ۸pﺣ۸es avec fourreaux ﺣ triscﺣ۷les. Les soies longues portent des traces de cuirs aux intersections des diffﺣ۸rents parties de la poignﺣ۸es : un disque de cuir entre la garde et la fusﺣ۸e, un disque de cuir entre la fusﺣ۸e et le pommeau et un dernier disque entre le pommeau et le tﺣ۹ton teminale au sommet duquel est ﺣ۸crasﺣ۸e la soie. Gﺣ۸nﺣ۸ralement un rivet est placﺣ۸ sur ce tﺣ۹ton. La longueur totale ne dﺣ۸passe jamais 13,5cm. Les soies courtes sont terminﺣ۸es par une bague ouvragﺣ۸e sur laquelle vient s'ﺣ۸craser la soie. De faﺣ۶on gﺣ۸nﺣ۸rale la forme de poignﺣ۸e du type ﺣ triscﺣ۷le ﺣ la forme d'un os, l'autre avec les griffons, d'un os avec en plus le tﺣ۹ton terminal schﺣ۸matisant une forme anthropomorphe. Enfin un dernier dﺣ۸tail, les fourreaux ne dﺣ۸passent rarement les 55cm. VAE VICTIS
http://www.archeoart.org
Retourner vers Histoire / Archﺣ۸ologie Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistrﺣ۸ et 31 invitﺣ۸s
Accueil |
Forum |
Livre d'or |
Infos Lègales |
Contact
Conception : Guillaume Roussel - Copyright © 1999/2009 - Tous droits rèservès - Dèpôts INPI / IDDN / CNIL(1006349) / SCAM(2006020105) | |