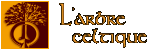TrÃĻs bien Muskull, tu as saisi le fond du problÃĻme. Tu vas pouvoir embrayer sur l'arpent
FrÃĐdÃĐrique, la question est courte, mais la rÃĐponse l'est beaucoup moins. Un livre indispensable, Les paysans gaulois, de F. Malrain, P. Meniel, V. Matterne, ed. Errance / INRAP, 2002.
@+Pierre