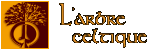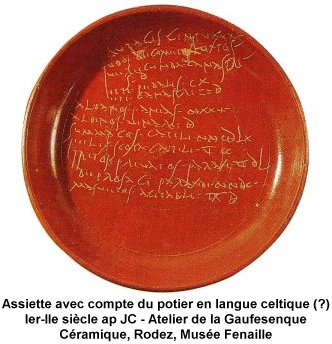Tout dabord, je tiens à m'excuser: je ne savais pas du tout que cet auteur se rattachais au "nÃĐo-druidisme". J'espÃĻre que ce ne sera pas perçus comme une volontÃĐ de ma part d'aller à l'encontre du mot d'ordre du forum dont je respecte entiÃĻrement l'ÃĐthique.
Donc mea culpa, encore une fois.
Cela dis, je m'interrogeais seulement sur ces ateliers mais je ferais mes recherches moi meme et essaierais d'Être plus prudente la prochaine fois.
Voila, re-bonsoir à tous.
Alara