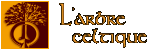Les mystÃĻres insondables, dignes de la ville dâYs, de lâÃĐvolution maritimo-commerciale et de lâÃĐcheveau des grands axes de navigation mer/fleuves sur la façade Atlantique ont de quoi nous laisser perplexes.
Ainsi Burdigala ou lâimpitoyable, mais belle histoire à lâenvers, â en clin dâÅil et en deux volets â dâune ville portuaire gauloise, dâavant lâÃĐpoque romaine, et qui aurait eu de quoi, de prime abord, et donc a priori, sâenorgueillir de dÃĐcouvertes fracassantes.
Pourtant, plouf dans lâeau !!!
Bordeaux - L'histoire
Bordeaux, l'autre capitale
Toute ville a son mystÃĻre, son secret intime. Bordeaux le conserve, rive gauche, dans une sorte d'obstination gasconne à ne pas se dÃĐployer au nord. FiÃĻre et frondeuse, Bordeaux la Girondine saura ne jamais se soumettre à ses envahisseurs et maÃŪtres successifs. L'opulence de la citÃĐ marchande n'aura pas peu contribuÃĐ Ã garantir cette belle indÃĐpendance de cÅur et d'esprit.
GÃĐrard Guicheteau
http://www.lepoint.fr/dossiers_villes/d ... did=129566
ÂĐ le point 25/04/03
Au commencement du monde, il y avait les Graves, deux ou trois basses collines d'alluvions et de cailloux en pente douce, un espace que cernaient les forÊts et que ravinaient deux courtes riviÃĻres et l'eau ÃĐchappÃĐe des fonts. Rive droite, sur des falaises de calcaires et de mollasses creusÃĐes de grottes, au-delà d'un marÃĐcage recouvert et dÃĐcouvert selon les marÃĐes, de petits hommes se chauffaient au soleil entre deux chasses à l'auroch ou à l'ours. Bordeaux n'ÃĐtait encore que ÂŦ ça Âŧ : une plage de graves inclinÃĐe vers la Garonne et deux criques perpendiculaires au fleuve, les embouchures de la DevÃĻze et du Peugue.
Cependant, la vÃĐritable nouveautÃĐ historique allait Être l'entrÃĐe en scÃĻne d'une grosse barque remontant cette fois le courant, portÃĐe par le flux de la marÃĐe comme une branche morte, voile affalÃĐe. La barque arrivait, disait-on, des terres borÃĐales qui, au-delà du fleuve OcÃĐan, fournissent le fer et l'airain, le plomb et l'ÃĐtain, l'or et l'argent, les pierres prÃĐcieuses et l'ambre. Elle inaugurait la voie la plus courte entre l'Atlantique et la MÃĐditerranÃĐe. Il ne serait plus nÃĐcessaire de contourner la pÃĐninsule des IbÃĻres ou de longer l'Afrique. Des ÃĐchanges commençaient entre ce que les marins aventureux allaient chercher au Nord, au milieu des glaces, des brumes et des rochers dÃĐchirants, dans ces ÂŦ ÃŪles Âŧ que Strabon dÃĐcrivit, et ce qui venait de la Grande GrÃĻce ou de la PhÃĐnicie.
Les premiers habitants des Graves allaient se tenir cois jusqu'Ã ce que survÃŪnt du cÅur de la Gaule, de l'intÃĐrieur de la boucle d'un autre grand fleuve, la Loire, un peuple gaulois indÃĐpendant d'esprit et de mÅurs, les Bituriges - les Vivisques (vibisci) comme ils se nommaient pour se distinguer des Berrichons, les Bituriges cubi. Burdigala ÃĐtait fondÃĐe sous ce nom ; elle allait s'agrandir et devenir un emporion (un comptoir) majeur.
Burdigala, castrum et comptoir
Ainsi, la ville se fit par le commerce, uniquement par le commerce. On peut mÊme dire qu'elle en ÃĐtait l'essence, comme le seront avec elle, mais plus tard, Londres, Venise, Anvers ou LÞbeck. Et commerce veut dire ÃĐchanges, ouverture, voyages, idÃĐes larges sur le large. Pour vendre, pour acheter, il fallait aller loin et imaginer. Sur place, le profit eÃŧt ÃĐtÃĐ maigre. Pour la bonne raison que Burdigala s'ÃĐdifiait au centre d'un dÃĐsert de ÂŦ landes Âŧ. Et que le ÂŦ bassin de population Âŧ n'ÃĐtait pas assez important pour ÃĐpuiser les stocks. Mais les Bituriges, gens avisÃĐs, ÃĐtaient là pour Être des marchands, des entrepreneurs de croisiÃĻres, et non pour faire les marins. à cette tÃĒche, ils allaient employer de rudes spÃĐcialistes qui avaient fait leurs preuves : des Basques, des IbÃĻres, des Santones, des Bretons.
Quand les lÃĐgions romaines ÂŦ pacifieront Âŧ la Gaule, les Bituriges vibisci accepteront volontiers les vainqueurs, car l'ordre favorise le commerce. Ils ne se fourvoieront pas avec les guerriers ÂŦ chevelus Âŧ de VercingÃĐtorix. S'ils se montrÃĻrent à Rome pour le triomphe, à la suite de Jules CÃĐsar et de Publius Crassus, chef des lÃĐgions conquÃĐrantes, ce fut à titre de marchands, pas de vaincus. Plus tard, Bordeaux deviendra une des capitales de la province d'Aquitaine qui s'ÃĐtendait de la Loire aux PyrÃĐnÃĐes. Mais elle s'installera uniquement sur la rive gauche. Ville ouverte, d'abord, puis ÂŦ ville carrÃĐe Âŧ, ceinte de murailles, au carrefour des routes venant ou conduisant au MÃĐdoc, aux ports de l'Adour et aux villes gallo-romaines de Marmande, Agen, Montauban, Toulouse. Le Nord s'arrÊtait rive droite, face au forum. La batellerie rÃĐgnait.
La paix romaine, qui dura quatre cents ans, a lÃĐguÃĐ Ã la citÃĐ l'ordonnancement de sa partie centrale, des reliefs de constructions et des noms de rue tels que ÂŦ Piliers de Tutelle Âŧ ou ÂŦ Ausone Âŧ. La premiÃĻre appellation perpÃĐtue le souvenir d'un temple à la divinitÃĐ tutela (tutÃĐlaire), protectrice de Bordeaux ; la seconde cÃĐlÃĻbre l'ÃĐcrivain latin bordelais Decimus Magnus Ausonus, Ausone (310-385), fils de Jules, qui fut prÃĐcepteur de l'empereur Gratien, puis prÃĐfet des Gaules, consul et propriÃĐtaire de vignobles. Le principal dieu romain de Burdigala, nul ne s'en ÃĐtonnera, fut et resta Mercure. Comme se plaÃŪt à le souligner Camille Julian (un Marseillais, historien de Bordeaux et grand spÃĐcialiste de la Gaule, contemporain d'Ernest Lavisse) : ÂŦ Il n'y a pas de dieu dont on trouve ici plus de statues... Âŧ Jupiter, alias Jovis en latin, n'a droit qu'au souvenir d'un temple, par la rue et la Porte Dijeaux. Bacchus, plutÃīt que Dionysos, demeure prÃĐsent par une autre sorte de don, la vigne et le cÃĐpage biturica.
ÂĐ le point 25/04/03 - N°1597 - Page 216
http://www.lepoint.fr/dossiers_villes/d ... did=129566
e. I/II