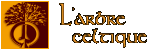Salut à tous!
J'ai mis en forme ce soir les rÃĐflexions qui suivent: vous inspirent-elles?
Mare aux moustiques, abreuvoir de l'armÃĐe et marais saxon et celtoroman christianisÃĐ.
Poull hwibed, ?Coriosopitum (Quimper?), Saint-Mars-la-Jaille.
Essai.
Sur les quelque 1440 toponymes inventoriÃĐs par Michel Kervarec dans la commune de RezÃĐ (Loire-Atlantique, 44), je n'en trouve qu'un seul qui soit apparemment clairement composÃĐ d'un terme dÃĐsignant un ou des insectes. Il s'agit de l'Ouche-Moucheron. Si ce Moucheron n'est pas tout simplement un nom de personne (nom de famille actuellement reprÃĐsentÃĐ dans le nord est de la France: Moucheron, Mousseron (?), Mouqueron), propriÃĐtaire oÃđ occupant du lieu, on peut penser aux cinq Poulhibet de Basse-Bretagne citÃĐs par Albert Deshayes (interprÃĐtÃĐs comme: mare aux moucherons, mouchettes, moustiques).
L'examen du rÃĐpertoire des toponymes de Bouvron (Loire-Atlantique, 44) - Dictionnaire des noms de lieux de Bouvron, de HervÃĐ Tremblay - ne rÃĐvÃĻle que deux insectes ayant explicitement laissÃĐ leur nom â bien sÃŧr dialectal â dans la toponymie. Les avettes (abeilles) y sont trois fois reprÃĐsentÃĐes et le guerzillon (grillon) une fois. On ne peut exclure pour "guerzillon" un sobriquet. Dans la rÃĐgion, on affuble de ce mot "gueurzillon" les gringalets ou les personnes de faillie mine.
Si Poulhibet ne reprÃĐsente pas "trou d'eau + mouchettes", on peut penser à un plÃĐonasme breton-gaulois, avec le sens redoublÃĐ de "trou d'eau". Les cinq sites sont sur des ruisseaux ou riviÃĻres (eau courante donc et non eau stagnante propice à la prÃĐsence des moustiques ou autres moucherons).
Y a-t-il plÃĐonasme ÃĐgalement, mais germano-gaulois, Ã Saint-Mars-la-Jaille? Le site du bourg, dans une dÃĐpression, est celui d'un marÃĐcage dans lequel court paresseusement une Erdre qui prend ses aises. Jaille est trÃĻs probablement issu d'un des noms gaulois du marais (voir par exemple en occitan limousin).
(RÃĐf. PBA p. 50) Les colonies saxonnes des ÃŪles de la Loire âles Saxons sont attestÃĐs vers 463 à Angersâ furent-elles complÃĻtement dÃĐtruites en 465? Elles auraient pu laisser leur nom germanique du marais à Saint-Mars-la-Jaille, accolÃĐ au nom celte conservÃĐ en roman, tout comme à (Petit- adjectif accolÃĐ au 17e s.) Mars, plus en aval sur l'Erdre, avec les restes de l'ensemble temenos et thÃĐÃĒtre rural gallo-romain situÃĐs prÃĻs du Vieux-Bourg dans les marais, monuments peut-Être susceptibles d'attirer et fixer les "pirates" saxons, et à Saint-Mars-de-Coutais, au sud de la Loire, sur le Tenu, non loin du lac de Grand Lieu, de Deas (= Saint-Philbert-de-Grandlieu) et de la Loire.
Beaucoup plus tard et sous l'influence de l'abbaye Saint-MÃĐdard de Doulon, prÃĻs Nantes, ces 'mar-' auraient ÃĐtÃĐ christianisÃĐs. Il fallait que Medardus se prononce alors dÃĐjà en roman Mard. ChristianisÃĐs, sauf le nom de Petit-Mars, puisqu'une paroisse primitive y existait dÃĐjà avec une ÃĐglise sur une ÃŪle de l'Erdre, sous le patronage de saint Denis. NÃĐanmoins il fallut tout de mÊme christianiser le ruisseau coulant aux abords sud du temenos-thÃĐatre par trop ÃĐvocateur de l'anciennes religion: on le baptisa ruisseau de Saint-MÃĐdard, et on crÃĐa une nouvelle paroisse limitrophe à celle de Petit-Mars, mais sur une hauteur cette fois, la paroisse de Saint-Mars-du-DÃĐsert.
Quimper pourrait avoir eu comme nom antique Coriosopitum, possible "armÃĐe + point d'eau". Cf.:
1) Poulbet, Poulhuybet en 1566, poull = mare, hameau avec ruisseau (dÃĐnivellÃĐ de 20 m sur 600 m) et avec sentier-chaussÃĐe à cheval sur le ruisseau, en Guilligomarc'h (29).
2) Toul Houibet, ÃĐcrit Toullaubet (noter la graphie "au", cf. *sopit-) sur la carte de Cassini, en Duault (22). Le Toul, "trou", est probablement le vallon avec ruisseau (intermittent) signalÃĐ sur la carte de Cassini, 40 m de pente sur 600 m, permettant peut-Être l'accÃĻs du bÃĐtail à un point d'eau sur un autre ruisseau, permanent celui-ci.
3) Poulhibet (je lis difficilement Ponthuibet ou Poulhuibet sur la carte de Cassini) sur le Blavet en MÃŧr-de-Bretagne (22), Ã une confluence doublÃĐe du passage d'une route ancienne (diffÃĐrente de la proche voie romaine Rennes-Carhaix), Ã la limite de Saint-Aignan.
4) Poulhibet (Pontubet, fausse lecture d'une graphie -ul- lue -nt-? sur la carte de Cassini, Poulhuibet en 1536) à un confluent, sur le Scorff, en BernÃĐ (56), là oÃđ les territoires de Guilligomarc'h, BernÃĐ et Plouay se rejoignent.
5) Poulhibet (Peuhibet sur la carte de Cassini, mauvaise lecture de Penhibet ou Poulibet?), Ã une confluence, Ã la jonction de Locmalo, LangoÃŦlan et PloÃŦrdut, sur le Scorff en PloÃŦrdut (56).
Trois sites de confluences sur cinq occurrences donc.
L'interprÃĐtation par hibet < gaulois *sopit- "abreuvoir" peut raisonnablement dans ces cas concurrencer celle par breton c'hwibet "moucherons, mouchettes, moustiques". Il semblerait que les noms d'insectes ou de tout petits animaux soient peu productifs en toponymie âmais je pense à la romaneâ: parfois "mare aux sangsues", mention de guÊpes, d'abeilles, en Charentes de "cagouilles" (escargots), de fourmis, de papillons.
Quimper, "confluent", fut-il Coriosopitum?
Les attestations ne sont malheureusement que mÃĐdiÃĐvales.
B. Tanguy, dans son Dictionnaire des noms de Communes du FinistÃĻre; 1990, p. 186, interprÃĻte le mot corisopitensis qualifiant l'ÃĐvÊque de Quimper vers 1050 comme une forgerie dÃĐrivÃĐe de Coriosopitum lu dans la "Notice des provincesâĶ" et y figurant suite à une erreur de copiste qui n'aurait su reconnaÃŪtre coriosolitum (= en rapport avec la citÃĐ de Corseul). Il faut donc supposer :
1) que coriosolitum et coriosopitum dÃĐsignent la mÊme rÃĐalitÃĐ,
2) que la forgerie "servit à lÃĐgitimer l'anciennetÃĐ du siÃĻge ÃĐpiscopal".
Mais oÃđ sont les ÃĐlÃĐments probants en faveur de cette ÃĐventuelle forgerie?
R. Giot suit B. Tanguy, p. 45 de Premiers Bretons d'Armorique (2003).
L. Fleuriot se demandait, parait-il, s'il ne fallait pas comprendre "l'abreuvoir de l'armÃĐe", suivi par A. Raude.
J. Quaghebeur, p. 85 de "La Cornouaille du 9eau12e s.", mentionne aussi le problÃĻme. Elle opinerait (p. 85) pour l'opinion de Waquet (l'ÃĐvÊchÃĐ de Quimper aurait recouvert le territoire d'un pagus osisme â NDR: tardivement promu en civitas, avec chef-lieu promu lui aussi?), et remarque toutefois que les deux mentions "civitas coriosopotum" et "civitas osismorum" figurent dans un mÊme manuscrit de Corbie. Faut-il donc lire "coriosolitum" en place de "coriosopotum" comme proposÃĐ par B. Tanguy? Mais alors la question de l'origine de l'ÃĐvÊchÃĐ de Quimper et de son siÃĻge ÃĐpiscopal reste entiÃĻre, le territoire de l'ÃĐvÊchÃĐ ne recouvrant que la partie mÃĐridionale de l'ancienne citÃĐ des Osismes.
En dÃĐfinitive, pour trancher, il faudrait, comme l'ÃĐcrit R. Giot, dÃĐcouvrir une inscription, par exemple sur une borne leugaire ou milliaire, du nom antique de Quimper ou de son pagus.
Cordialement,
GÃĐrard
|
poull hwibed, coriosopitum, saint-mars-la-jailleModÃĐrateurs: Pierre, Guillaume, Patrice
5 messages • Page 1 sur 1
GÃĐraaaaaaaaaaaard !
Tu ne vas pas recommencer : "Quimper pourrait avoir eu comme nom antique Coriosopitum, possible "armÃĐe + point d'eau". Cf.: " C'est un faux dÃĐmontrÃĐ et une discussion close depuis longtemps ! ****************** Pour les noms de lieux de Haute Bretagne, voir : J-Y LE MOING : Les noms de lieux de Haute Bretagne Coop Breizh 1990. JC Even "Apprends tout et tu verras que rien n'est superflu".
Hugues de Saint-Victor.
poulhibetChers lecteurs, chers contributeurs à ce forum et laboratoire d'idÃĐes!
Citation: "C'est un faux dÃĐmontrÃĐ et une discussion close depuis longtemps !" Pour ce que j'ai lu, ce n'est pas si ÃĐvident. "La controverse n'est sÃŧrement pas close", LÃĐon Fleuriot, OB, 1980, p. 251. Et effectivement, J. Quaghebeur en parle encore dans sa thÃĻse de 1994 publiÃĐe (avec la mention "2e ÃĐdition") en 2002. Et Giot, dans PBA (2003), p. 45. Il y a en fait plusieurs problÃĻmes. Le plus ancien des manuscrits (Corbie) de la Notitia Prouinciarum et Ciuitatum Galliae, et environ 80 autres manuscrits donnent une civitas en âpâ et 12 en âlâ (Fleuriot, OB, p. 251). Mais ce n'est pas la majoritÃĐ qui a forcÃĐment raison, dans ce domaine en tous cas! 1) Alors, Coriosolites ou Coriosopites? 2) Puis, Quimper ou pas Quimper? J'ai lu aussi Planiol, qui me semble avoir une opinion de NormandâĶ Visiblement le problÃĻme, à lire les ÃĐrudits, n'est pas tranchÃĐ. J'avoue que B. Tanguy, il est vrai dans un ouvrage de vulgarisation (1990), ne rÃĐussit pas à me convaincre. Il a peut-Être publiÃĐ ailleurs ses arguments sur la forgerie? Ou bien d'autres personnes en ont-elles de plus convaincants? En fait ma rÃĐflexion porte plutÃīt sur l'apparent constat de la raretÃĐ de l'emploi de noms d'insectes en toponymie (impression erronÃĐe? Y a-t-il eu des ÃĐtudes publiÃĐes?), et sur, au contraire, une certaine abondance des tautologies ou plÃĐonasmes, quand une vague culturelle vient recouvrir une couche ancienne, on conserve l'ancien nom en le prÃĐcisant et complÃĐtant par sa traduction. Non loin de chez moi, par exemple, il y a un "Bois de Lonluc". Français "bois"et latin "luc" sont (quasi) synonymes, et "lon" pourrait fort bien Être un reste normand (londe) ou vieux-breton (voire gaulois?) "loin" du mÊme sens "bois". On aurait alors "bois+bois+bois". Mais je ne suis pas allÃĐ chercher les formes anciennes de ce lieu-dit. Donc les "fubu, c'hwibu, c'hwibet" ("moucherons") des Poulhibet me laissent pensifs, quand l'ÃĐvolution de *sopit- en "hibet" me semble fort plausible et que le lieu ne semble pas plus propice (et sÃŧrement moins que des eaux stagnantes) qu'un autre endroit des riviÃĻres concernÃĐes à la prolifÃĐration des moustiques. Mais toute cette matiÃĻre est ÃĐvidemment toujours des plus dÃĐlicates à manier. A-galon / Cordialement, GÃĐrard (avec un a long?)
Mon trÃĻs cher GÃĐrard
(Ca te va comme çà ?). Tu devrais dÃĐcomposer ta question, sinon, il va y avoir enfourchement avec risques de dÃĐraillements. Les moskitos d'un cÃītÃĐ, Quimper-Corentin de l'autre. ================= Ceci dit, le site originel de ce qui est aujourd'hui Quimper / Kemper, à l'ÃĐpoque gallo-romaine, est ERGUE (un seul ErguÃĐ comprenant E-Armel et -E-Gaberic). Il s'agit d'une sorte d'ÃĐperon gaulois sur l'actuelle butte de Lok-Maria. (cf Ar Menn- Chasse-MarÃĐe). Nous l'avons ÃĐvoquÃĐ Ã propos d'Erquy ( = *werk-) et Carhaix - Vorgium ( *work-) Les terres donnÃĐes aux moines ÃĐtaient situÃĐes dans les marÃĐcages situÃĐs en bas de cette butte, dans le confluent, d'oÃđ le nom actuel de la Rue du Frout = rue du tourbillon (provoquÃĐ par la confluence des riviÃĻres), qui prÃĐcisÃĐment, longe le jardin de l'ÃĐvÊchÃĐ et de la cathÃĐdrale. Des moustiques dans un marÃĐcage ??? pourquoi pas; ce n'est que trÃĻs frÃĐquent !!! ================== Quant aux Coriosopites, il s'agit d'une bÃĐvue, dans le cadre des recherches du XIXÃĻ siÃĻcle, à propos des Curiosolites (ou l'on plaçait les Ambiliates à Lamballe et les Diablintes sur la Rance !) aussi bien que d'une inspiration erronnÃĐe à partir de la station romaine : * Coriosopitum / Corstopitum : le forteresse romaine du Mur d'Hadrien, aujourd'hui Corchester, en Corbridge, Northumberland =================== Pour ce qui est de l'ÃĐvÊchÃĐ de Quimper, il faut bien noter, dÃĻs le dÃĐpart, que, conformÃĐment à la mise en place des siÃĻges des ÃĐvÊchÃĐs gallo-romains, c'est Carhaix / Vorgium puis Quadruvium > Corofesium > Carohaise qui ÃĐtait dÃĐsignÃĐe pour Être le siÃĻge de l'ÃĐvÊchÃĐ ossisme. Mais que du fait de l'implantation britto-romaine en cette fin du VÃĻ siÃĻcle, cet ÃĐvÊchÃĐ a ÃĐtÃĐ ÃĐphÃĐmÃĻre, et a ÃĐtÃĐ redistribuÃĐ en deux siÃĻges : l'un à Quimper pour les Gaulois du sud de la citÃĐ ossisme , d'oÃđ Corn-O-Galliae > Cornouaille, et l'autre au Yaudet (Vetus Civitas) ( TrÃĐgor + LÃĐon+ nord GoÃŦlo), pour les Britto-Romains =================== Il est ÃĐvident que si tu as pour rÃĐfÃĐrence Alan RAUDE, qui par ailleurs est une connaissance amicale, mais adepte de la thÃĐorie des Cornovii ÃĐponymes dee la Cornouaille, nous risquons de ne pas Être d'accord longtemps. ==================== Quand au "Houibet", il me semble qu'il s'en trouve un sur le route de Carhaix à Lorient, aux environs du FaouÃŦt, dans une vallÃĐe. (Poull-Houibet ou Toull-Houibet, à vÃĐrifier). ==================== PS : je joue à domicile, sur mes terres ! DÃĐbat tout à fait amical. JC Even "Apprends tout et tu verras que rien n'est superflu".
Hugues de Saint-Victor.
J'ai trouvÃĐ! B. Tanguy explique plus longuement que dans Noms de communes du FinistÃĻre la genÃĻse de CoRisopitensis p. 100 dans "le FinistÃĻre de la prÃĐhistoire à nos jours" (1991), et là je comprends mieux. Besoin de lÃĐgitimer l'anciennetÃĐ de l'ÃĐvÊchÃĐ de Quimper pour ne pas tomber sous la coupe archiÃĐpiscopale de Tours, l'archevÊchÃĐ de Dol-de-Bretagne ÃĐtant une crÃĐation "moderne" (849) et trÃĻs politique. Ca tient la route. L'absence de "Plou" autour de Quimper (cf carte p. 104) est frappante aussi. Est-elle le signe d'une moins grande implantation bretonne? Il me semble avoir lu autrefois une tentative de rÃĐfutation dans Hor Yezh. Le LÃĐon et le TrÃĐguier auraient donc eu un ÃĐvÊchÃĐ Ã eux, "breton" plus qu'armoricain, de bonne heure?
Pour nos lecteurs, on peux rappeler que Yaudet = c'heoded = Ciotat =Ciudad = civitas = citÃĐ, à peu prÃĻs. Le Poulhibet sur la route Lorient-Carhaix est celui de BernÃĐ, pas trÃĻs loin du FaouÃŦt. A Quimper, je n'ai pas remarquÃĐ de Poul- ou Toul- Hibet. Oui pour la prÃĐsence des "mouchettes" dans les marÃĐcages, mais pas là oÃđ il y a du "Frout" (tourbillon, courant fort) à Quimper. Le dÃĐbat sur les "cornoviens" m'est inconnu, par contre c'est par une page d'un site de A. Raude que j'ai pris connaissance de l'hypothÃĻse de Fleuriot *sopit > hibet, enfin, paraÃŪt-il! Bien cordialement et à + GM
5 messages • Page 1 sur 1
Retourner vers Histoire / ArchÃĐologie Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistrÃĐ et 24 invitÃĐs
Accueil |
Forum |
Livre d'or |
Infos Lègales |
Contact
Conception : Guillaume Roussel - Copyright © 1999/2009 - Tous droits rèservès - Dèpôts INPI / IDDN / CNIL(1006349) / SCAM(2006020105) | |