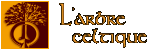Je recherche des documents sur le commerce entre celtes et Grecs, en particulier l'origine des matÃĐriaux ÃĐchangÃĐs, les routes empruntÃĐes, la monnaie (?) utilisÃĐe et tout le toutim.
Le but est de crÃĐer une carte lisible et cohÃĐrente sur ce sujet.
a vot' bon coeur;
Et bravo pour ce site vivant et trÃĻs riche.
Antoine
http://am.pedagogie.free.fr/